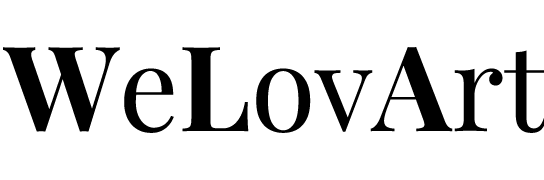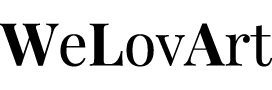Quand est né ton amour pour la couture ?
C’est ma passion depuis toujours. Quand j’étais petit, je coupais dans les rideaux de ma mère, je piquais la poupée Barbie de ma voisine pour l’habiller. J’ai toujours voulu être couturier, mais mes parents voulaient que je fasse un métier plus sérieux, plus viril.
Tu as finalement réussi à les convaincre ?
Oui, mais ça n’a pas été facile. Après le bac, j’ai voulu intégrer une école de mode. Ma mère m’a dit : « Fais-le, mais il faut que tu sois sûr de ton choix. » Mes parents avaient beaucoup de clichés sur la mode. Ils voyaient ça comme un milieu dangereux, avec de la drogue… Je viens d’une famille de provinciaux, donc c’était un peu extravagant pour eux. Mais je me suis vraiment battu et j’ai intégré une formation en stylisme et modélisme à l’école Bellecour de Lyon, où je suis resté trois ans. J’étais l’un des meilleurs élèves, et mes parents étaient rassurés quand ils voyaient mes bonnes notes.

Photo David Mayenfisch
Et tes débuts dans le métier, comment c’était ?
Après l’école, je suis monté à Paris, mes dessins sous le bras. J’avais à peine 20 ans, je ne connaissais personne là-bas, je ne savais même pas où loger ! J’ai fait des pieds et des mains pour intégrer une maison de haute couture, avenue Montaigne. Je rêvais de travailler pour un créateur de mode qui s’appelait Jean-Louis Scherrer. Au bout de six mois, j’ai réussi à obtenir un entretien avec son premier d’atelier. Soit il m’engageait pour balayer, soit je retournais en province. Rentrer chez mes parents en Haute-Savoie… ce n’était pas possible. Alors je lui ai dit que j’étais prêt à tout pour travailler. J’avais tellement la niaque qu’il m’a embauché comme petite main !
Petite main, c’est-à-dire ?
Au départ, j’étais apprenti. Il y a plein de choses auxquelles je ne pouvais pas toucher. Les tissus coûtent une fortune, donc on n’a pas le droit à l’erreur. Il faut savoir que la haute couture est très hiérarchisée. J’ai commencé à faire des ourlets, puis des toiles, et j’ai réussi à présenter mes dessins à Monsieur Scherrer. J’ai très vite grimpé les échelons car je me suis investi à fond. À l’époque, il avait deux stylistes, dont un qui me faisait la guerre. Un jour, il m’a même fait un croche-patte dans l’escalier !
Photo David Mayenfisch (gauche) / Croquis de Roland Chessel (droite)
À ce moment-là, tu arrivais à vivre de ton métier ?
Les fins de mois étaient difficiles. Je gagnais 4 000 francsCorrespond à 600 euros environ. More, et plus de la moitié de mon salaire me servait à me payer une chambre de bonne. C’était vraiment la misère ! (rires) Mais j’étais heureux car je réalisais mon rêve de travailler avenue Montaigne. J’y suis resté cinq ans.
Et puis Monsieur Scherrer a finalement vendu sa boîte. Je venais de commencer à travailler en parallèle pour un styliste à Genève. En un week-end, je gagnais 1 000 francs suissesCorrespond à 950 euros environ. More, soit plus que 4 000 francsCorrespond à 600 euros environ. More français. Ça mettait du beurre dans les épinards ! J’ai donc quitté la France pour la Suisse, un peu à regret. J’adorais Paris, j’avais toujours des bons plans pour sortir et m’amuser, même sans argent. À Genève, je m’ennuyais. Même si je gagnais mieux ma vie, il n’y avait pas grand-chose à faire.
Ce calme ne t’a pas poussé à partir ?
Non puisque j’ai pu monter ma propre affaire peu de temps après mon arrivée en Suisse. J’avais 27 ans. C’était assez simple car il n’y a pas beaucoup de couturiers à Genève. J’ai repris la clientèle du styliste pour lequel je travaillais et qui avait arrêté. C’était la suite logique de mon parcours.
Photo David Mayenfisch
Ça fait longtemps que tu as ton atelier de couture. Qui sont tes clientes ?
Plus de la moitié d’entre elles viennent du Moyen-Orient, car c’est dans leur tradition d’avoir beaucoup de tenues. Je les habille depuis leur plus jeune âge et je m’occupe maintenant de leurs filles. Mais je reconnais qu’avoir une nouvelle cliente en face de moi est un bonheur. Je prends le temps de découvrir sa personnalité, c’est très important. Il faut qu’il y ait un feeling. Si j’ai un mauvais ressenti dès le début, je ne fais pas la tenue. Je suis conscient que c’est un luxe de faire ça, mais j’en ai les moyens.
Tu crées notamment des robes. Combien de temps te faut-il pour en confectionner une ?
Je reçois une première fois la cliente dans mon salon. J’observe sa façon de bouger, elle m’exprime ses envies. Au deuxième rendez-vous, je lui présente des croquis. Puis il faut compter environ trois essayages. En général, ça prend un mois et demi, mais tout dépend de la complexité de la robe.
Comment est-ce que tu définirais ton style ?
J’aime les vêtements épurés, sobres. Pour moi, les matières sont belles en noir, surtout le velours qui est très sombre, très profond. C’est tellement un basique incroyable… Il n’y a pas une seule femme à qui le noir ne va pas. Je me lâche un peu plus sur les sacs, c’est limite bling-bling ! (rires) Comme la plupart des femmes ne prennent plus le temps de bien s’habiller, je pense qu’un sac peut faire la différence sur une tenue.
Photo David Mayenfisch (gauche) / Photo Olivier Bain (droite)
Tu as l’impression que ton métier a évolué depuis tes débuts ?
La main d’œuvre d’aujourd’hui est beaucoup moins expérimentée qu’à mon époque… Les formations sont moins exigeantes, peut-être parce que les gens ne sont plus habitués au luxe. Avant le prêt-à-porter, les femmes ne portaient quasiment que du sur-mesure. Elles avaient l’habitude des belles coupes, du tombé parfait. Aujourd’hui, tout est produit en masse. Les vêtements de qualité ont pris de la valeur. J’ai du mal à trouver des belles matières, car maintenir l’artisanat coûte cher.
Ça ne te décourage pas ?
Non, c’est un métier magique. Même quand je n’ai rien à faire, si j’ai une idée, je vais dans mon atelier. La couture, c’est toute ma vie, je ne pense même pas à la retraite. Ça durera jusqu’à la fin.